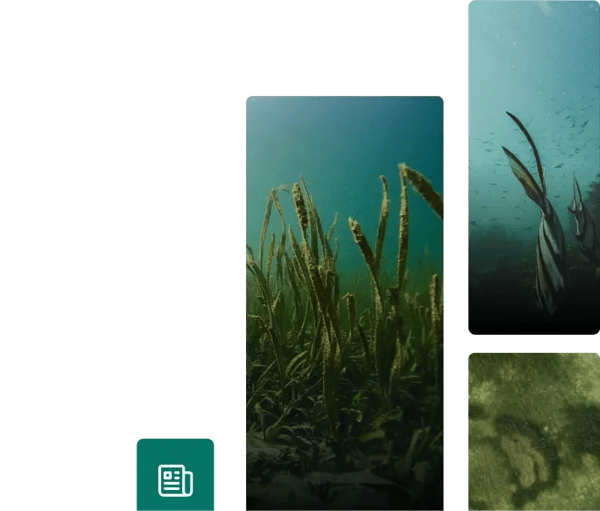Le lien entre la contribution climatique et le reporting CDP
Le CDP (Carbon Disclosure Project) est une organisation internationale de référence dans le domaine du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Acteur clé de la décarbonation, il joue un rôle central dans la promotion de la transparence environnementale en incitant les entreprises, les villes et les États à mesurer, gérer et divulguer leurs impacts environnementaux. Pour en savoir plus sur le CDP, lire notre article dédié.
En complément des efforts de décarbonation, le CDP propose également des orientations claires concernant l’usage de contribution climatique dans le cadre d’une stratégie climatique globale. Cet article explore les recommandations du CDP en matière de crédits carbone, avec un accent particulier sur l’importance de la qualité des crédits et de la transparence dans leur utilisation, afin de limiter les risques de greenwashing et de garantir l’intégrité environnementale. Intégrée de manière rigoureuse et complémentaire aux actions de réduction directe, la compensation peut renforcer la crédibilité d’une stratégie climat alignée sur les objectifs de l’Accord de Paris.
Qu’est qu’est la contribution climatique?
La contribution climatique est définie comme un outil qui permet d'accélérer les efforts pour ne pas dépasser un réchauffement planétaire de 1,5°C. Elle ne doit en aucun cas se substituer à une démarche robuste de réduction des émissions. Au contraire, elle vient compléter une stratégie de réduction solide, fondée sur une évaluation rigoureuse de l’empreinte carbone de l’entreprise.
Contrairement à une vision centrée uniquement sur l’évitement ou la capture de CO₂, la contribution climatique offre de multiples co-bénéfices. Elle soutient notamment la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies, en générant des impacts sociaux positifs comme la réduction de la pauvreté, l’égalité des sexes ou l’accès à l’énergie. Elle reflète ainsi une approche intégrée de la durabilité, qui associe enjeux environnementaux et dimensions sociales.
Qu'est-ce qu'un crédit carbone ?
Un crédit carbone représente une tonne métrique de CO2 équivalent (tCO2e) évitée ou séquestrée. Il inclut d'autres gaz à effet de serre convertis selon leur potentiel de réchauffement global (PRG), comme le méthane. Ces crédits, générés par des projets certifiés (ex: VCS, Gold Standard), sont émis, suivis et retirés sur des registres dématérialisés dédiés. Il existe deux catégories principales de crédits : les crédits de conformité (ou quotas d'émission), utilisés dans des systèmes réglementaires comme l'ETS européen, et les crédits carbone volontaires, échangés sur le Marché Volontaire du Carbone (VCM) pour des engagements non obligatoires.
Bien qu’ils puissent être utilisés pour appuyer une stratégie climatique ou accompagner une démarche de zero émission net, ils ne remplacent pas les réductions d’émissions directes. Leur usage doit rester complémentaire et encadré pour éviter les risques de greenwashing.
Comment les crédits carbone peuvent-ils contribuer à la neutralité climatique à l’échelle mondiale?
Pour atteindre la neutralité carbone à l’échelle mondiale, les entreprises doivent concentrer leurs efforts sur la décarbonation tout en contribuant parallèlement à des projets de réduction ou de séquestration des émissions de carbone. Plus nous soutenons des projets climatiques de haute qualité, plus l’impact positif sur le climat et les écosystèmes naturels est important. L’utilisation optimale des crédits carbone consiste à les considérer comme une contribution à un objectif climatique global. La neutralité carbone mondiale exige à la fois une réduction des émissions de gaz à effet de serre et un renforcement de la capacité d’absorption du carbone, que ce soit par des solutions fondées sur la nature ou sur la technologie. Les crédits carbone contribuent à ces deux volets. De plus, les projets financés par ces crédits génèrent souvent des co-bénéfices, tels que le soutien à la biodiversité, à la santé et à l’égalité des genres, en cohérence avec les Objectifs de développement durable des Nations Unies.
Croissance et défis du marché des crédits carbone
Selon son document “Position Paper on Carbon credits”, le CDP constate une croissance rapide de l'utilisation des crédits carbone à l’échelle mondiale. Il souligne cependant que l'absence de normes claires concernant la transparence et la crédibilité de ces crédits complique l'évaluation rigoureuse des efforts de décarbonation réellement entrepris par les entreprises. L'Union européenne espère réaliser une réduction de 55% de ses émissions d'ici 2030 dans le cadre de ses efforts pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Cependant, l’absence de régulation harmonisée sur le marché mondial volontaire entraîne un manque de transparence, des incohérences dans les rapports et un risque de mauvaise comptabilisation des émissions.
Chez ClimateSeed, nous garantissons l'intégrité et la qualité supérieure des crédits carbone. Nous travaillons exclusivement sur le marché volontaire du carbone (VCM). Grâce à notre processus rigoureux en trois étapes, incluant l’analyse des risques et une vérification approfondie, nous nous assurons que tous les projets sont alignés avec les Objectifs de Développement Durable (ODD). Nous accompagnons les entreprises dans l'achat de crédits carbone de haute qualité, que ce soit via des acquisitions ponctuelles, des accords pluriannuels ou le financement de projets initiaux. Pour une transparence accrue, notre plateforme centralise toutes les informations : portefeuille détaillé des projets, suivi des retraits, certificats, et un tableau de bord intuitif pour un historique des transactions sécurisées.
Prise de position du CDP sur les crédits carbone
Le CDP a publié une note de position sur les crédits carbone en 2023. Ce document expose la vision du CDP sur l'utilisation des crédits carbone et formule 3 principes clés directeurs à respecter.
Principe 1: Sur les objectifs de réduction
Le CDP recommande que les entreprises définissent d’abord des objectifs de réduction d’émissions clairs et ambitieux avant de recourir aux crédits carbone. Ces derniers doivent venir en complément des actions directes de réduction, et non s’y substituer. L’utilisation prématurée des crédits, ou leur substitution aux efforts concrets, peut affaiblir la crédibilité des actions climatiques des entreprises. Cela augmente également les risques de greenwashing et d’imprécisions dans les bilans carbone.
Selon l’initiative SBTi, les entreprises doivent établir des objectifs à court et long termes alignés avec une trajectoire de réchauffement limitée à 1,5 °C. D’autres instances telles que la VCMI (Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative), les Oxford Offsetting Principles ou encore le groupe d’experts de l’ONU sur le net-zéro (UN HLEG) soulignent également l’importance de fixer ces objectifs avant toute utilisation de crédits carbone. Par exemple, le Claims Code of Practice de la VCMI n’autorise les entreprises à faire des déclarations climatiques crédibles que si elles se sont déjà engagées à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et ont communiqué publiquement leurs objectifs à court terme. « Si l’utilisation et la déclaration des crédits carbone ne sont pas crédibles, comparables et cohérentes, elles risquent de compromettre l’intégrité de la comptabilité des émissions dans son ensemble. » – CDP
Principe 2: Sur l'achat de crédits carbone
Le CDP insiste sur la qualité des crédits achetés. Seuls les crédits vérifiés et fondés sur des bases scientifiques permettent de garantir un impact réel et positif. Les entreprises doivent faire preuve de diligence raisonnable (ou due diligence en anglais), afin de s’assurer que l’ensemble des vérifications préalables est effectué, notamment en s’appuyant sur des agences de notation ou des intermédiaires du marché
Comment évaluer la qualité d’un crédit carbone ?
Selon le rapport “CDP Carbon Credits Paper” pour qu’un crédit carbone soit considéré de haute qualité, plusieurs critères essentiels doivent être respectés :
- Additionnalité : La réduction ou la séquestration des émissions doit être rendue possible uniquement grâce au financement généré par la vente des crédits. Si le projet avait eu lieu de toute façon, sans ce soutien financier, alors le crédit ne représenterait pas un bénéfice climatique réel.
- Pérennité (ou permanence) : Les réductions d’émissions doivent être durables dans le temps. Les projets doivent intégrer des mécanismes de suivi, de gestion des risques et de compensation (par exemple via des tampons ou des fonds d’assurance) pour éviter tout reversement, c’est-à-dire une perte future de carbone stocké, comme dans le cas d’une forêt détruite.
- Prévention des fuites (leakage) : Un projet ne doit pas entraîner un déplacement des émissions vers un autre site ou secteur. Par exemple, si la déforestation est évitée dans une région, elle ne doit pas simplement être déplacée ailleurs.
- Absence d’impacts négatifs : Les projets doivent être conçus de manière à ne pas nuire aux écosystèmes, aux économies locales ou aux communautés. L’implication active des communautés locales et des peuples autochtones est essentielle pour garantir le respect des droits humains, la protection de la biodiversité et l’acceptabilité sociale du projet.
Le Conseil d'intégrité du marché volontaire du carbone (ICVCM) propose des critères pour garantir la qualité des crédits. CDP recommande également de prendre en compte les risques d’annulation d’impact et les effets négatifs potentiels sur les plans économique ou social.
Principe 3: Sur la comptabilisation des crédits
Le CDP appelle à une comptabilisation rigoureuse et transparente des crédits carbone pour éviter les doubles comptages, les doubles utilisations, et les doubles enregistrements. L’utilisation des crédits doit être documentée séparément des émissions de GES dans les rapports d'entreprise.
Selon le cadre de l’Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM), une comptabilité carbone crédible repose sur l’évitement de trois formes de double comptabilisation :
- la double émission (plusieurs crédits émis pour une même réduction d’émissions),
- la double utilisation (le même crédit utilisé plusieurs fois), et
- la double revendication (la même réduction revendiquée à la fois par un État dans le cadre de ses contributions nationales NDC et par une entreprise privée).
Ces erreurs compromettent l'intégrité environnementale et la crédibilité des engagements climatiques. Pour garantir une utilisation transparente des crédits carbone, le CDP recommande de s’appuyer sur des registres de crédits reconnus, qui assurent une traçabilité claire du projet, de l’année d’émission (vintage), du statut du crédit, et de son origine. Il est également essentiel de distinguer les crédits carbone des émissions brutes (Scope 1, 2 et 3) dans les rapports, afin d’éviter toute confusion entre réductions réelles et compensations. Enfin, les entreprises doivent divulguer des informations détaillées sur les crédits utilisés : volume, nom du projet, standard de certification, démonstration d’additionnalité, ainsi que la date et le mode d’annulation du crédit (retrait, usage ou mise hors service), conformément au Claims Code of Practice de la VCMI.
Le CDP collecte des données via son Questionnaire sur le changement climatique afin d’évaluer les progrès des entreprises vers des objectifs alignés avec la SBTi, ainsi que les détails sur les crédits carbone annulés ou retirés. Cela permet de situer l’entreprise dans sa trajectoire de décarbonation au moment où elle choisit d’utiliser des crédits.
Depuis 2023, le CDP a élargi son questionnaire pour intégrer des informations plus précises sur la qualité des crédits utilisés : méthode de vérification, type de projet, standard, et critères de qualité tels que l’additionnalité, les risques de non-permanence, les fuites d’émissions et les garanties environnementales et sociales. Des champs spécifiques permettent aux entreprises de déclarer le type de crédit, le standard de vérification et le statut d’annulation. De nouvelles colonnes exigent désormais des explications détaillées sur l’évaluation de l’additionnalité, la gestion des risques, et les mesures prises pour éviter les impacts négatifs sur l’environnement et les communautés.
Ces exigences sont conçues pour s’aligner sur les cadres de l’ICVCM et de la VCMI, assurant ainsi une cohérence internationale dans la comptabilisation et l’usage des crédits carbone.
Conclusion
La contribution climatique peut jouer un rôle utile dans une stratégie climatique d’entreprise, à condition qu’elle soit mise en œuvre avec rigueur, transparence et en complément d’efforts réels de réduction des émissions. Le recours aux crédits carbone ne doit jamais se substituer à l’action directe, mais s’inscrire dans une démarche alignée sur les trajectoires net-zéro et les meilleures pratiques internationales. Le CDP, à travers son Questionnaire sur le changement climatique, fournit un cadre structurant pour évaluer la qualité, la transparence et l’intégrité de l’utilisation des crédits carbone. En exigeant des données précises sur les projets, les standards, les garanties sociales et environnementales, ainsi que sur la vérification des crédits, le CDP aide les entreprises à rendre leurs engagements climatiques crédibles et traçables.
Chez ClimateSeed, nous partageons cette exigence de transparence et d’intégrité. En travaillant exclusivement sur le marché volontaire du carbone (VCM) et en appliquant un processus de sélection rigoureux, nous aidons les entreprises à identifier des crédits carbone de haute qualité, y compris des crédits premiums, qui peuvent renforcer leur stratégie de durabilité. Ces contributions climatiques peuvent être intégrées de manière crédible dans leur reporting extra-financier et communiquées efficacement dans des cadres de référence comme celui du CDP.
FAQ
La contribution CDP désigne le fait pour une organisation de fournir volontairement des données relatives à ses émissions de gaz à effet de serre, sa gestion des risques climatiques et ses initiatives environnementales afin d'encourager la transparence environnementale.
Un bon score CDP renforce la confiance des investisseurs, améliore la réputation de l'entreprise et facilite l'accès à certains marchés soucieux de durabilité.
Non, ce reporting demeure volontaire, mais de nombreuses entreprises y adhèrent pour afficher leur responsabilité environnementale et répondre aux attentes croissantes de transparence.
Les entreprises partagent au CDP des informations détaillées sur leurs émissions directes et indirectes (scope 1, 2 et 3), leurs stratégies de réduction des émissions et leurs initiatives de contribution climatique.
Le reporting CDP permet aux entreprises d'identifier leurs impacts environnementaux et ainsi de mieux cibler et prioriser leurs initiatives de contribution climatique.
Vous pourriez aussi aimer
Articles similaires

Comment préparer et remplir le CDP ?

La norme Corporate Net-Zero de la SBTi